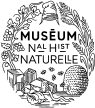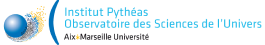Météorites « fraîches » : un aspect caractéristique
Pour pouvoir rechercher les météorites sur le terrain, il est indispensable de savoir les reconnaître ! Or, les météorites fraîchement tombées ont un aspect caractéristique qui permet de les distinguer aisément des roches terrestres… Deux caractéristiques principales bien visibles sur les figures 1, 2 et 3 distinguent la plupart des météorites fraîchement tombées des roches terrestres : (1) leur aspect extérieur a été sculpté par leur traversée de l’atmosphère, (2) dans leur grande majorité, les météorites contiennent du fer sous forme métallique (Fe0, par opposition à Fe2+ ou Fe3+ lorsque le fer est associé à de l’oxygène dans les minéraux silicatés ou les oxydes).

Figure 1- Tranche de l’une des pierres de la météorite de Villalbeto de la Peña, tombée en Espagne dans la province de Palencia, le 4 janvier 2004. La croûte de fusion de cet échantillon, particulièrement épaisse, se distingue bien. On voit aussi plusieurs grains de métal, notamment un au centre, et, enfin, les taches de rouille qui parsèment l’intérieur clair de la roche.
6,1 x 4,2 x 0,6 cm – 21,8 g.
Collection : Muséum national d’Histoire naturelle.
© Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle.

Figure 2- L’une des pierres de la météorite de Mocs, tombée en Roumanie, le 3 février 1882.
6 x 3,5 x 3,1 cm – 112,1 g.
Collection : Muséum national d’Histoire naturelle.
© Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle.

Figure 3- L’une des pierres de la météorite de Haniet-el-Beguel,
trouvée en 1888 en Algérie.
12,4 x 9,3 x 5,8 cm – 1 899 g.
Collection : Muséum national d’Histoire naturelle.
© Le Règne Minéral, photo L.-D. Bayle.
Des météorites sculptées par leur entrée atmosphérique
La traversée de l’atmosphère est un phénomène bref et destructeur. La plupart des corps célestes qui pénètrent dans l’atmosphère de la Terre n’y survivent pas (chap. 5). La fraction de ces matériaux qui parvient jusqu’à la surface de la Terre est fortement marquée par ce voyage au cours duquel leur surface se couvre d’une « croûte de fusion » et ils acquièrent des formes caractéristiques.
Toutes les météorites fraîches présentent ainsi une croûte de fusion, résultat de l’échauffement violent de leur surface par le plasma qui les a enveloppées pendant l’essentiel de leur traversée. Ce plasma fond et vaporise la surface de la roche dont la taille diminue progressivement et le liquide résiduel à la disparition du plasma se solidifie sous la forme d’une fine pellicule vitreuse qui recouvre toute la surface de la roche. Cette croûte de fusion d’épaisseur millimétrique est le plus souvent d’un noir mat, mais elle peut être satinée ou même brillante, voire transparente selon la nature de la roche qui a fondu. Elle peut présenter des traces d’écoulement et, dans les rares cas où la météorite est riche en éléments volatils, de très fines vésicules. La présence de cette croûte de fusion fait que l’intérieur et l’extérieur d’une météorite apparaissent systématiquement différents alors qu’ils ont la même composition, comme la croûte d’un pain apparaît différente de sa mie.
Dans la grande majorité des cas, le corps incident se fragmente à une ou plusieurs reprises, ce qui confère aux pierres qui atteignent le sol des formes caractéristiques : leurs faces généralement lissées par l’abrasion par le plasma font entre elles des angles nets susceptibles d’être très aigus, et les arêtes entre ces faces sont le plus souvent émoussées (Figure 1). Cet aspect varie selon que la cassure que l’on regarde s’est produite à plus ou moins basse altitude. En cas de cassure à faible altitude, le plasma n’a pas le temps de jouer son rôle égalisateur : les faces peuvent rester irrégulières et les arêtes plus vives (Figure 2). Il est ainsi rarissime qu’une météorite présente des formes globalement arrondies comme celles d’un galet roulé et leur surface n’est jamais mamelonnée comme celle d’un chou-fleur. Par ailleurs, leur surface ne présente généralement pas de bulles de taille significative ni de trous marqués, mais parfois des creux adoucis qui peuvent ressembler à des traces de doigts dans la pâte à modeler. De telles cavités, que l’on appelle «regmaglyptes» ont été formées par des tourbillons dans l’atmosphère.
Du métal dans les météorites
La seconde caractéristique majeure des météorites qui aide à leur identification est que la plupart d’entre-elles contiennent du métal. Celui-ci est le plus souvent un minéral accessoire qui ne constitue que quelques pour-cents de la roche, mais il peut représenter une fraction très importante de certaines météorites voire même leur intégralité (Figure 3). Cela constitue une différence majeure avec les roches terrestres. En effet, la différenciation de la Terre a engendré un noyau dans lequel s’est rassemblé tout le fer sous forme métallique qui se trouvait dans les couches supérieures de notre planète. Notons que cela ne signifie pas que le fer est absent des roches de la surface de la Terre : il n’y est simplement pas sous forme métallique (Fe0), mais associé à de l’oxygène dans des oxydes ou dans des silicates (Fe2+ ou Fe3+). L’Âge du Fer (qui remonterait jusqu’à 3 000 ans avant notre ère en Afrique) correspond au moment où les humains ont commencé à maîtriser la séparation du fer et de l’oxygène pour fabriquer du métal à partir de minerais d’oxyde de fer. Les objets métalliques en fer antérieurs sont en fer météoritique !
Comme il n’y a presque jamais de fer métal dans les roches de la surface de la Terre, une roche naturelle qui en contient, a toutes les chances d’être une météorite ! Or, la présence de métal dans une roche est souvent facile à établir car elle lui confère des propriétés particulières. Des roches contenant du métal ont une masse volumique plus élevée que les autres (la roche est plus lourde pour un même volume), et ce d’autant plus que le métal représente une fraction importante de cette roche. Ainsi, les météorites de fer, essentiellement constituées de métal, ont une masse volumique près de trois fois plus élevée que celle des roches terrestres ! Dans les cas où le métal est présent sous forme de grains isolés, ceux-ci peuvent être visibles grâce à leur aspect brillant à l’intérieur de la roche ou bien sous la croûte, mais le signe le plus fréquent est qu’une très légère oxydation de ces grains par les eaux météoriques se manifeste par des taches de rouille sur les silicates avoisinants. Ces taches se distinguent bien sur les figures 1, 2 et figure 2 dans encart 6.
La présence de fer sous forme métallique dans les météorites leur confère aussi une susceptibilité magnétique et une conductivité plus importantes que celles des autres roches. La manière la plus simple de détecter la première est évidemment d’utiliser un aimant, mais une telle opération a des conséquences néfastes pour la roche : elle détruit sa signature magnétique propre, acquise au moment où la roche s’est formée, une importante source d’information sur le corps parent dont elle est issue. Pour cette raison, dans le cadre du projet de sciences participatives FRIPON/Vigie-Ciel (chap. 5 et 6), l’usage d’un aimant est proscrit. À la place, il est recommandé d’utiliser un « MetMet », dispositif électronique conçu au CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement), qui permet de mesurer à la fois la susceptibilité magnétique d’une roche et sa conductivité. Il permet donc aussi de distinguer une roche terrestre contenant de la magnétite (susceptible) d’une météorite contenant du métal (susceptible et conductrice). Le projet Vigie-Ciel a financé l’acquisition de 23 MetMet qui ont été distribués en France et mis à la disposition de ses relais sur le territoire (chap. 6).