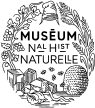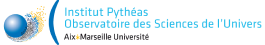On imagine souvent les astronomes sous leurs coupoles astronomiques, manipulant d’imposants télescopes afin de capter d’infimes photons issus de galaxies lointaines et invisibles à l’œil nu… On les imagine beaucoup moins allongés dans l’herbe, les yeux rivés vers le ciel en essayant de capter la lumière produite dans l’atmosphère terrestre par l’arrivée à très grande vitesse d’une poussière extraterrestre à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de lui. Et pourtant…
Le météore, un phénomène accessible à tous, tout-le-temps
Le grand public connaît les météores sous l’appellation trompeuse « d’étoiles filantes ». Et s’imagine aussi souvent qu’elles ne sont observables qu’en août. Coupons court aux idées reçues : les « étoiles filantes » n’ont rien d’étoiles, ces boules de plasma comme le Soleil, et localisée à très grandes distances de notre planète. Les « étoiles filantes » sont la manifestation lumineuse de l’entrée à très grande vitesse d’un météoroïde dans l’atmosphère. Evénement qui donne naissance à la fameuse « étoile filante », scientifiquement désignée par le terme « météore » (à ne pas confondre avec les météorites).
De plus, les météores sont observables tout-le-temps : à n’importe quel moment de la nuit, et toute l’année. Il est cependant des périodes plus favorables. Ainsi, mieux vaut observer en fin de nuit qu’en début pour observer plus de météores. Et il arrive que la Terre traverse des nuages de poussières libérées par des comètes ou des astéroïdes. La traversée de tels zones plus denses en particules crée une pluie météorique plus ou moins intense, les plus actives d’entre elles pouvant être la source de 80 à 120 météores par heure. C’est notamment le cas aux alentours du 12 août avec la pluie des Perséides, mi-décembre avec les Géminides et début janvier avec les Quadrantides. La Terre effectuant annuellement le même trajet autour du Soleil, les zones de poussières sont relativement identiques d’une année sur l’autre, permettant de prévoir les périodes les plus favorables pour l’observation, ainsi que d’éventuels événements exceptionnels comme les sursauts d’activité, voire les tempêtes de météores.

Figure 1- Les météores d’une même pluie semblent provenir d’une même zone du ciel appelée radiant. Il faut que ce dernier soit levé pour que la pluie soit observable. Crédit: Jeff Dai
Quand observer ?
Comme indiqué précédemment, des pluies météoriques sont actives toute l’année : l’idéal est donc de consulter un calendrier des pluies météoriques actives, afin de déterminer les périodes pendant lesquelles elles sont actives, voire même les dates et heures où elles atteignent leur maximum d’activité. De tels événements sont relativement faciles à anticiper, même si des surprises (bonnes ou mauvaises) sont toujours possibles, car la science des météores n’est pas une science exacte comme les éclipses ou les occultations planétaires ! Il subsiste toujours une part d’aléatoire dans l’activité météorique, ce qui fait tout leur charme.
Pensez également à vérifier si la Lune est présente dans le ciel ou pas : cette dernière éclairant considérablement le ciel et les paysages terrestres, elle va gommer du ciel les météores les moins lumineux, comme elle le fait avec les étoiles. Mieux vaut donc éviter les observations les nuits de Pleine Lune, et privilégier les horaires où elle n’est pas présente dans le ciel. Pour les pluies les plus actives, la présence de notre satellite naturel demeurera une gêne, mais n’empêchera pas l’observation des météores, vu leur nombre. Pour les pluies les moins actives, elle peut par contre être rédhibitoire.
Enfin, ce n’est pas parce qu’une pluie météorique est active qu’elle est observable tout le temps ! Certaines sont actives en plein jour, donc il faudra attendre la nuit tombée pour en profiter (quand c’est possible). Une des caractéristiques des météores issus d’une même pluie est qu’ils semblent provenir d’une même région du ciel, appelé le radiant (Figure 1). Or, il faut que ce dernier soit levé pour que la pluie soit observable ! Ainsi, il est inutile de guetter d’éventuelles Léonides en première moitié de nuits de novembre : le radiant ne se lève que vers minuit ! Et plus il sera haut dans le ciel, plus le nombre de météores observables sera conséquent.
Cela fait finalement beaucoup de paramètres à vérifier et à prendre en compte pour observer les météores au bon moment, et dans les meilleurs conditions. Et encore, nous n’avons pas parlé de la météorologie, qui peut elle aussi jouer les trouble-fête…
Où observer ?
Comme pour toute observation en astronomie (hormis pour le Soleil, la Lune et les planètes), l’idéal est d’observer sous les ciels les plus sombres possibles, afin de pouvoir voir les météores les moins lumineux (et également les plus nombreux). Mieux vaut donc éviter d’observer en ville, et essayer d’échapper à toute source de pollution lumineuse directe ou indirecte. Cette dernière peut être largement amplifiée en cas de brume, fine couverture nuageuse ou d’aérosols dans l’atmosphère. Les cieux les plus purs et transparents peuvent donc limiter l’amplification de ces nuisances lumineuses, comme de celles engendrées par la présence de la Lune.
Comment observer ?
Un maître-mot : le confort ! Il est inenvisageable d’espérer programmer une session d’observation de météores si c’est pour passer son temps à espérer que cette dernière prenne fion ou qu’elle ne se solde par un torticolis ! Vous allez observer le ciel, et comme votre corps vous le rappelle régulièrement, nous ne sommes pas conçus pour lever la tête en permanence vers le ciel. Il faudra donc vous équiper d’une chaise longue ou d’un tapis de sol pour vous installer en position horizontale et limiter les douloureuses gymnastiques du cou.
Ensuite, en été comme en hiver, rappelez-vous que les nuits sont fraîches, voire glacées, et ce d’autant plus que vous allez rester immobile pendant de longues heures. Donc couvre-vous en conséquence ! Tenue de ski en décembre, petit sweat et pantalon long en été vous permettront de vous concentrer sur les observations plutôt que sur votre hypothermie naissante. Des boissons chaudes peuvent être bues, mais attention, le certaines d’entre elles peuvent accentuer la sensation de froid après ingurgitation en dilatant les vaisseaux sanguins.
Une fois installé, gardez le matériel pour enregistrer les météores (dictaphone, papier, crayon, lampe rouge, montre, lacet/corde, etc.) à proximité pour limiter au maximum les pertes de temps à chercher un objet.
Quoi observer et enregistrer ?
Une fois l’installation effectuée, vous voilà sous le ciel… Mais qu’enregistrer ? Les météores ? Pas encore… Car l’un des objectifs de l’observation des météores est de quantifier l’activité observée. Or cette dernière va être dépendante de l’état du ciel (couverture nuageuse, pollution lumineuse, présence de la Lune), de son obstruction (par des reliefs, bâtiments), de l’observateur (acuité visuelle, fatigue)… Il va donc falloir enregistrer tous ces paramètres afin d’homogénéiser les données de tous les observateurs et qu’elle n’en soient pas dépendantes.
Concernant l’état du ciel, il vous faudra donc enregistrer :
- son obstruction par la couverture nuageuse ou un relief/bâtiment;
- sa magnitude limite (la luminosité de la plus faible étoile visible), qui va permettre de déduire la qualité du ciel (pollution lumineuse, couverture nuageuse faible, acuité de l’observateur).
Il vous faudra également noter les horaires de début et de fin de votre session d’observation, la zone du ciel observée, ainsi que toutes les pauses prises (afin d’avoir une idée du temps réel d’observation par rapport au nombre de météores enregistrés).
Et enfin, vous allez pouvoir enregistrer vos étoiles filantes !
Ainsi, dès que vous en apercevez une, vous devez immédiatement noter :
- son heure d’apparition (ou au moins une tranche horaire) ;
- son appartenance ou non à une pluie météorique, en vérifiant avec le lacet ou la corde que sa trajectoire se prolonge bien jusqu’à un radiant (ce qui sous-entend que vous avez mémorisé la position des radiants actifs au cours de la nuit), voire sa trajectoire (tracée sur des cartes spécifiques) ;
- sa magnitude (en la comparant aux étoiles étalons que vous aurez repérées) ;
- sa vitesse apparente (en °/s) ;
- son éventuelle coloration ;
- la présence ou non d’une éventuelle traînée persistante et sa durée ;
- la fragmentation ou non du météoroïde ;
- toute autre information qui vous paraît utile.
Restera ensuite à dépouiller toutes les données, et à les formater dans un rapport d’observation à envoyer à l’International Meteor Organization pour qu’elles puissent être intégrées dans la base de données visuelles de météores (VMDB) et utilisées avec toutes celles récoltées partout dans le monde. Ce qui permet ainsi de tracer des courbes d’activité 24h/24, 7j/7 et donc d’analyser l’activité des différentes pluies au cours du temps, et d’une année sur l’autre.
Un article, paru dans l’Astronomie (juin 2022, vol.35, n°161), complète les informations contenues dans cette page. la référence est toutefois la méthode définie par l’International Meteor Organization, qui permet une collecte homogénéisée des observations partout dans le monde.
par Karl Antier, 13/02/2025