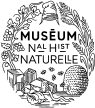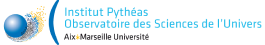Contrairement aux idées communément admises, et malgré leur appellation populaire trompeuse, les « étoiles filantes » sont tout, sauf des étoiles. Elles sont même la manifestation de tous petits grains de matière extraterrestre qui ont eu la bonne idée de venir nous rendre visite.
Et pour casser définitivement les idées reçues, elles sont visibles toute l’année, même si elles sont plus nombreuses à certaines périodes.
Enfin, leur nom scientifique n’est pas « étoile filante », mais « météore ». Explications sur un phénomène accessible à tous, curieux du ciel comme astronomes professionnels !
Le météore, un phénomène atmosphérique
Pris dans sa terminologie la plus large, un météore (du grec μετέωρος, metéōro, qui signifie « élevé », « dans les airs ») est un phénomène qui a lieu dans l’atmosphère (Figure 1) : il englobe donc ce que nous appelons communément « étoiles filantes », mais également les précipitations (pluie, neige, etc.), les phénomènes lumineux (arc-en-ciel, halos, parhélies, etc.) et/ou électriques (éclairs, aurores boréales, etc.), et même les phénomènes associés aux aérosols (tempêtes de sable, etc.). C’est de cette même racine qu’est issu le terme « météorologie », donc l’étude des phénomènes atmosphériques, sans nécessairement qu’elle traite d’étoiles filantes ! Dans ces pages, nous utiliserons le terme « météore » pour désigner un phénomène astronomique particulier de cette grande famille : celui associé à l’entrée à très grande vitesse d’un météoroïde dans l’atmosphère terrestre, autrement dit, la célèbre « étoile filante ».

Figure 1- L’arc-en-ciel, comme tous les phénomènes atmosphériques, des précipitations aux aurores boréales, font partie de la grande famille des météores, d’où la météorologie tire son nom. Crédit : K. Antier
Une rencontre à très grande vitesse avec une particule extraterrestre
Car l’espace n’est pas vide ! Même si pour nous, Terriens, quitter notre berceau et notre atmosphère semble indiquer l’entrée dans le vide absolu, en réalité, le Système solaire est peuplé de toutes petites particules rocheuses ou métalliques, les météoroïdes, dans des densités plus ou moins élevées. Ceci est visible depuis la surface terrestre sous forme de lumière zodiacale, notamment à certaines périodes de l’année (et sous des cieux bien sombres). La multitude de toutes petites poussières rediffusent la lumière du Soleil, visible alors sous forme d’un fuseau s’élevant le long de l’écliptique (et donc des constellations du Zodiaque, d’où son nom) : c’est la lumière zodiacale (Figure 2).

Figure 2- Entre les planètes, le Système solaire n’est pas vide : des milliards de petites particules et poussières rocheuses ou métalliques sont également présentes. Si elles peuvent difficilement être observées au télescope, la lumière du Soleil qu’elles diffusent sont visibles à l’œil nu, lorsque le ciel est clair et que la géométrie céleste est favorable, sous forme d’un fuseau lumineux s’élevant au-dessus de l’horizon le long de l’écliptique : c’est la lumière zodiacale, photographiée ici depuis le Cerro Paranal (Atacama, Chili). Crédit : ESO/Y. Beletsky
Mais ces poussières sont également visibles individuellement, lorsque leur trajectoire les amène à rencontrer la Terre. La vitesse de la « planète bleue » sur son orbite autour du Soleil est d’environ 30 km/s (soit 108 000 km/h). Dans son voisinage, les objets du Système solaire peuvent avoir des vitesses maximales de 42 km/s (environ 150 000 km/h). Ainsi, en fonction de la géométrie et de la vitesse relative de notre planète par rapport aux météoroïdes, ces derniers pénètrent dans l’atmosphère terrestre avec des vitesses comprises entre :
- 11,2 km/s (environ 40 300 km/h) si le météoroïde rencontre la Terre avec une vitesse relative quasi-nulle (par exemple s’il « suit » la Terre à 30 km/s) et est accéléré par la gravité jusqu’à atteindre la vitesse de libération de 11,2 km/s (environ 40 300 km/h) ;
- 72 km/s (près de 260 000 km/h) si le météoroïde voyage à 42 km/s et rencontre frontalement la Terre.
Le météore, ou « étoile filante », un phénomène lumineux
À de telles vitesses, lorsque le météoroïde pénètre dans les hautes couches de l’atmosphère (à environ 120 km d’altitude), il commence à rencontrer les molécules de l’atmosphère, qui deviennent de plus en plus denses au fur et à mesure qu’il pénètre profondément dans cette couche de gaz qui entoure notre planète. En rencontrant ces molécules, le météoroïde ralentit et sa surface s’échauffe, et se sublime. Parallèlement, les molécules atmosphériques rencontrées gagnent de l’énergie et s’excitent en s’ionisant (elles s’électrisent). Cet état d’excitation n’est cependant pas stable : les molécules rencontrées ne peuvent garder éternellement cette énergie gagnée. Elles vont donc se désexciter plus ou moins rapidement, et restituer l’énergie sous forme d’énergie lumineuse. Un cylindre lumineux de plusieurs dizaines de centimètres va apparaître sur la trajectoire atmosphérique du météoroïde. C’est ce dernier qui est visible depuis la surface terrestre sous forme « d’étoile filante » (Figure 3), scientifiquement appelé météore, et généralement observé pour des altitudes comprises entre 60 et 100 km d’altitude (le météore peut être observé jusqu’à des altitudes plus basses si le météoroïde est plus massif).

Figure 3- Météore (au sens « d’étoile filante ») brillant (et coloré) observé le 12 août 2021. Crédit : Miguel Claro
Lors d’entrées de météoroïdes très véloces ou massifs, l’atmosphère peut mettre plus de temps pour se désexciter et revenir à son état énergétique initial : une traînée persistante, qui peut être observer pendant plusieurs secondes, voire minutes, ou même dizaines de minutes peut alors être observée. Soumise aux vents d’altitudes, elle se déforme au fur et à mesure, formant des volutes en lieu et place de la traînée rectiligne initiale du météore.
Les météoroïdes ne sont pas répartis de manière homogène dans le Système solaire : nombre d’entre eux sont issus de comètes ou astéroïdes, et suivent donc des orbites plus ou moins proches de leur astre géniteur, formant des zones plus denses en particules. Lorsque la Terre rencontre une de ces zones, l’activité météorique augmente : une pluie météorique est alors observable. Les plus connues et actives d’entre elles sont les Perséides ou les Géminides.
par Karl Antier, 12/02/2025