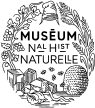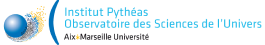L’atmosphère terrestre, un filtre à météorites ?
L’absence d’échantillons correspondant à certains types spectraux d’astéroïdes dans nos collections de météorites pourrait bien avoir une origine autre que des modifications superficielles de la surface de ces astéroïdes par l’altération spatiale. Elle pourrait résulter d’un biais d’échantillonnage en lien avec la présence d’une atmosphère protectrice autour de la Terre. Il est possible que les matériaux les plus friables n’atteignent que rarement – voire jamais – la surface de la Terre sous forme d’objets massifs. Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que nos collections de poussières interplanétaires (capturées à haute altitude dans la stratosphère, par les collecteurs plats d’un avion U2) et de micrométéorites (récoltées par filtration d’immenses quantités de glace en Antarctique – Figure 1) contiennent des particules dont les types spectraux correspondent à ceux des astéroïdes manquants…

Figure 1- Collecte de micrométéorites dans les régions centrales antarctiques, à proximité de la station franco-italienne Concordia (Dôme C), en 2016. La neige collectée sera fondue de retour à la base pour en extraire les micrométéorites. © J. Duprat (CNRS – MNHN/Sorbonne Université)
On estime à 15 000 tonnes par an le flux de poussières cosmiques qui viennent grossir la Terre chaque année, dont environ les deux tiers sous forme de « sphérules cosmiques » produites par la fusion dans l’atmosphère du matériau incident originel. Le tiers restant est constitué de particules non fondues avec une minéralogie dominée par les pyroxènes et/ou les olivines. Les spectres de réflectance de ces particules non fondues ressemblent à ceux des astéroïdes des types B, C, Cb, Cg, P et D. Cela suggère que les matériaux issus de ces astéroïdes circulent sous forme finement divisée dans le milieu interplanétaire, ou bien qu’ils se fragmentent totalement lors de la traversée de l’atmosphère. Notons que les observations des étoiles filantes, qui accompagnent l’entrée atmosphérique des particules fines montrent qu’une fraction non négligeable d’entre-elles ont une origine cométaire ce qui est confirmé par la nature « ultra-carbonée » de certaines d’entre-elles qui présentent des enrichissements extrêmes en deutérium (allant de 10 à 30 fois les valeurs terrestres). Ainsi, les collections de micrométéorites ne sont-elles pas simplement des objets plus petits que les météorites : elles nous donnent accès à des corps-parents non représentés dans nos collections de météorites, les astéroïdes carbonés et les comètes.
 Extrait du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.
Extrait du dossier « Le programme FRIPON/Vigie-Ciel », par Brigitte Zanda, Asma Steinhausser, Jean-Philippe Uzan, Sylvain Bouley et François Colas. Paru dans Géochronique, Magazine des Géosciences n°166 (juin 2023), édité par la Société Géologique de France et le BRGM.